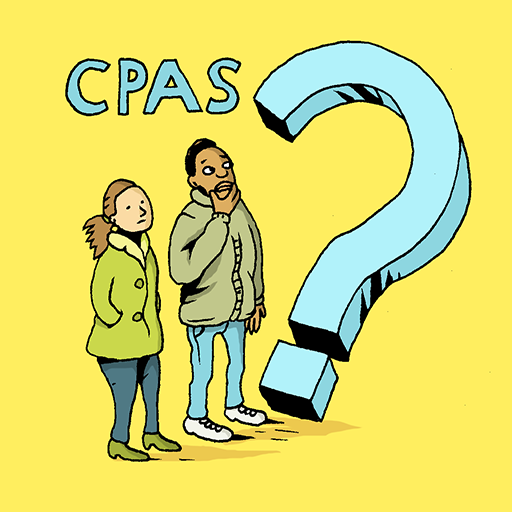Prise en compte des ressources
Dernière mise à jour : 01/10/2024
- Cass. 27 juin 2022, n° S.21.0054.F : la Cour de Cassation rappelle que, pour les étudiants de moins de 25 ans suivant des études, un projet individualisé d’intégration sociale doit être établi et que c’est à la lumière de celui-ci que s’apprécie la disposition au travail. En effet, elle considère qu’il n’existe pas en soi, dans le chef de la personne qui prétend au bénéfice du droit à l’intégration sociale et qui poursuit des études secondaires ou universitaires de plein exercice, d’obligation de démontrer une disposition même partielle au travail, tout dépendant des circonstances appréciées in concreto. C’est dès lors à l’aune du projet individualisé d’intégration sociale que doit s’apprécier la condition de la disposition et non sur la base de critères de fait extérieurs. Par ailleurs, la Cour de cassation considère également qu’il n’est pas exact que la disposition au travail est une condition dont la charge de la preuve incombe au demandeur, dans la mesure où, s’il appartient certes à ce dernier de démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi (article 3 de la loi), il n’en reste pas moins que le C.P.A.S. doit, en application de l’article 17, collaborer activement à la
charge de cette preuve lorsqu’est en jeu la condition de l’article 3, 5°, ce dont, selon le moyen, il résulte que la considération de l’arrêt suivant laquelle la demanderesse (qui établissait s’être inscrite dans une agence d’intérim) ne démontre aucune recherche de job d’étudiant ne suffit pas à justifier légalement la décision qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
- Cass., 19 janvier 2015, R.G. n° S. 13. 0084.F/1 : concernant les prestations familiales, la seule exonération est celle prévue à l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal, soit celle qui est appliquée à l’« intéressé(e) », s’entendant du/de la demandeur(se) de revenu d’intégration sociale, lorsqu’il/elle est allocataire et élève un ou des enfants mineurs. Ceci ne vaut pas pour l’enfant demandeur du revenu d’intégration sociale qui n’est pas allocataire et n’élève pas un enfant, de même que pour un parent en sa qualité de cohabitant avec son enfant majeur vivant avec elle, ce parent n’étant pas « l’intéressé » au sens de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal. L’article 22, § 1er, alinéa 1er, b) de l’arrêté royal s’applique aux ressources du/de la seul(e) demandeur(se) du revenu d’intégration, et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.
- Cass., 18 novembre 2019, n° S. 19.0021.F. : la Cour rappelle dans un premier temps l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale en ce qu’il règle la prise en compte des ressources des personnes avec qui le demandeur d’un revenu d’intégration cohabite, distinguant le partenaire de vie, conjoint, ou compagnon du demandeur, dont les ressources doivent être prises en compte, les ascendants ou descendants majeurs au premier degré, dont les ressources peuvent être prises en compte, et les autres cohabitants, dont les ressources ne peuvent pas être prises en compte. Dans un second temps, si le CPAS décide de prendre en considération les ressources des ascendants, il ne peut retenir que la partie des ressources qui dépasse le montant de revenu d’intégration au taux cohabitant. Mais la Cour dispose que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée, les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent, pour l’octroi fictif de ce revenu à ces ascendant ou descendant, qui n’est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération comme le prescrit l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
- Cour trav. Liège, 12 octobre 2021, R.G. n° 19/2542/A et 20/152/A : la Cour rappelle qu’en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs, la prise en compte par le CPAS des revenus de ces cohabitants correspond non à une obligation, mais à une faculté qui peut être soumise à l’appréciation des juridictions du travail. Le pouvoir judiciaire a en effet le pouvoir de contrôler l’usage que le CPAS fait de la faculté qui lui est accordée par l’article 34, § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. Le CPAS et le juge ont la possibilité de décider d’une prise en compte partielle des ressources des cohabitants.
- Trib.trav. La Louvière, 15 avril 2021, R.G. n° 20/1279/A : le tribunal rappelle que lors de la prise en compte des ressources des ascendants et/ou descendants majeurs avec lesquels cohabite le demandeur d’aide, l’un des critères retenus pour déterminer la nécessité et l’importance de l’aide à accorder réside dans la nécessité de garantir au ménage un budget global suffisant pour permettre de faire face aux besoins de chacun de ses membres, sachant que ce critère implique de tenir compte, parallèlement aux ressources, des charges personnelles de chaque membre du ménage. Par conséquent, l’intéressée est en droit d’obtenir un revenu d’intégration au taux cohabitant partiel. L’existence d’une présence effective du demandeur sur le territoire belge suffit donc à cet égard à l’estime de la Cour, quels qu’en soient le motif et/ou la durée, et ce, a fortiori lorsqu’un lien territorial manifeste existe entre l’aide demandée et la Belgique. Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume précise plus avant à cet égard que « l’aide médicale urgente, visée à l’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical ».